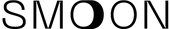Cycle des règles : les menstruations en question
Les règles ou menstruations désignent un phénomène naturel qui survient chaque mois chez la femme entre la puberté (12 et demi en moyenne en France) et la ménopause. Elles se manifestent par des saignements provenant de la muqueuse utérine. Leur durée peut aller de 3 à 7 jours. L’apparition du premier cycle menstruel signale que le système reproducteur a fini sa maturation. Ce qui sous-entend que le corps est en capacité d’accueillir une grossesse.


















Les règles, c’est quoi ?
À partir de la puberté, l’utérus se prépare à accueillir une grossesse éventuelle chaque mois. Durant ce cycle de préparation, l’endomètre (muqueuse utérine) s’épaissit et se remplit de vaisseaux sanguins. Si la fécondation n’a pas lieu, l’endomètre s’évacue en provoquant un saignement vaginal. C’est ce qu’on appelle les règles ou les menstruations. En général, les saignements durent de 3 à 8 jours.
Hors grossesse, ce cycle se répète chaque mois : on parle alors de cycle menstruel. Selon les femmes, la durée d’un cycle menstruel (du premier jour des règles au premier jour des règles suivantes) peut aller de 21 à 35 jours.
D'où vient le sang des règles ?
Le sang des menstruations provient de la muqueuse de l’utérus (endomètre). Pour comprendre ce phénomène, il faut expliquer les quatre phases du cycle menstruel.
- La phase folliculaire durant laquelle les œstrogènes (hormones produites par les ovaires) sécrétés en quantité croissante provoquent l'épaississement de la muqueuse utérine. Au cours de cette phase, les ovaires se préparent à ovuler. Sous l’impulsion du cerveau, l’hypophyse sécrète l’hormone folliculostimulante (FSH) qui stimule le développement de plusieurs follicules sur l’ovaire. Chacun de ces follicules (du latin folliculus : petit sac) contient un ovocyte. Un seul d’entre eux arrive à maturité et libère un ovocyte prêt à être fécondé dans la trompe de Fallope. Pendant qu’il mûrit, le follicule produit des œstrogènes, déclenchant l’épaississement de l’endomètre (muqueuse interne de l’utérus). Boostée par le taux élevé d’œstrogènes, la gonadolibérine (GnRH) entre en jeu en favorisant la sécrétion de l’hormone lutéinisante (LH).
- La phase d'ovulation au cours de laquelle l’hormone lutéinisante (LH) provoque la rupture du follicule (« petit sac » situé dans l’ovaire contenant un ovocyte) et libère un ovocyte qui va migrer dans la trompe de Fallope en direction de l'utérus. Entre le douzième jour et le quatorzième jour, le follicule ovarien arrivé à maturité libère l’ovocyte dans l’une des trompes de Fallope. Si des spermatozoïdes sont présents, la fécondation de l’ovule peut avoir lieu. Après avoir expulsé l’ovule, le follicule se transforme en corps jaune. C’est lui qui sécrète la progestérone pendant la deuxième période du cycle menstruel : la phase lutéale.
- La phase lutéale (ou phase progestative) pendant laquelle le follicule vide se transforme en corps jaune et sécrète de la progestérone stimulant la muqueuse utérine qui se prépare à accueillir un ovocyte fécondé. S’il y a fécondation (rencontre entre l’ovocyte et un spermatozoïde), l’ovocyte entame sa nidation. Il y a grossesse. S’il n’y a pas fécondation, la muqueuse utérine se désintègre et s’évacue par voie vaginale. C’est le retour des menstruations qui inaugurent un nouveau cycle menstruel.
- La phase menstruelle marquée par des saignements issus de la désagrégation de l’endomètre lorsqu’il n’y a pas de grossesse.
Quelle est la durée d'un cycle menstruel ?
Le cycle menstruel démarre au premier jour des règles et se termine au premier jour des règles suivantes. Ce cycle menstruel dure en moyenne 28 jours. Chaque femme étant unique, cette durée peut varier de 21 à 35 jours. En cas de cycle perturbé, il ne faut pas hésiter à en parler au médecin ou à la gynécologue.
Au départ, on préconise d'opter pour une culotte menstruelle pour flux abondant puis pour une culotte de règle standard pour flux moyen.
Comment calculer son jour d'ovulation ?
L’ovulation intervient en général entre le 14e et le 16e jour avant le début des règles suivantes. Les 6 jours avant et pendant l’ovulation sont appelés « fenêtre de fertilité », car c’est le moment où une fécondation peut se produire. Cette fenêtre peut varier d’une femme à l’autre selon la durée de son cycle menstruel. Pour certaines, le cycle menstruel est de 28 jours. On estime donc que le jour de l’ovulation se situe au 14e jour après les règles. Pour d’autres, ce cycle peut être plus court ou plus long. Cette variation peut donc décaler la date d’ovulation. Pour un cycle court de 21 jours, on calcule de la façon suivante 21-14 = 7. En clair, l’ovulation se produira selon toute probabilité au 7e jour après le début des règles. Pour un cycle long de 31 jours, le calcul est le suivant : 31-14 = 17. Ici, l’ovulation est censée se produire le 17e jour après le début des règles.
Calculer la date d’ovulation dans le cadre d’un cycle irrégulier est quasiment impossible.
Cependant, il existe une autre solution pour repérer le jour J : rester à l’écoute de son corps. En effet, certains signes ne trompent pas :
- Seins tendus ;
- Douleurs au niveau de l’ovaire qui libère l’ovocyte ;
- Accroissement de la libido ;
Pour repérer précisément le moment de l’ovulation, vous pouvez vous appuyer sur deux méthodes :
- L’observation de la glaire cervicale ;
- L’évolution de la température basale (température la plus basse que le corps affiche au repos)
L’observation de la glaire cervicale
L’aspect et la quantité de glaire sécrétée par le col de l'utérus varient au cours du cycle menstruel selon ce tempo :
- Durant la phase folliculaire, vous ne verrez aucune glaire cervicale apparente. Entre le 10ème jour et le 12ème jour, la sécrétion de glaire commence. Son aspect est opaque et sa consistance collante ;
- Au moment de l’ovulation, c’est-à-dire du 13ème jour au 15ème jour, la glaire cervicale est abondante, transparente et filante (texture proche du blanc d'œuf) ;
- Durant la phase lutéale, la sécrétion de glaire cesse.
L’apparition de la glaire cervicale prévient que l'ovulation est proche. Pour celles qui projettent de tomber enceinte, ce signal donne de précieuses informations sur la période de fécondité. Il permet aux femmes dont les cycles sont irréguliers de mieux cerner leur fenêtre de fertilité.
L’évolution de la température basale
La température du corps évolue au cours du cycle menstruel comme ceci :
- 36,8 °C ou un peu moins durant la phase folliculaire ;
- point de nadir (température la plus basse du cycle) au moment de l’ovulation ;
- 37 °C ou un peu plus après l’ovulation et durant toute la phase lutéale (la sécrétion de la progestérone provoquant une hausse de la température).
En suivant quotidiennement votre température basale (le matin au réveil), vous pourrez tracer une courbe de température de votre corps au dixième près qui vous permettra de déterminer votre date d’ovulation.
Quels symptômes ?
En dehors des saignements, les règles peuvent s’accompagner des symptômes suivants:
- Seins douloureux (déséquilibre au niveau des œstrogènes) ;
- Diarrhée, nausées, douleurs et crampes dans le bas du ventre et le bas du dos, (augmentation des prostaglandines entraînant des contractions utérines pour évacuer l’endomètre et le sang) ;
- Sommeil perturbé, troubles de l’humeur et migraines (perturbation des neurotransmetteurs dans le cerveau sous l’effet des œstrogènes) ;
- Acné (excès de sébum durant la période d’ovulation) ;
- Bouffées de chaleur et transpiration sous l’influence des hormones ;
- Fatigue (en cas de saignements abondants, les taux de globules rouges et de fer baissent dans le corps).
Chaque corps étant unique, il est possible de n’éprouver aucun de ces symptômes. En cas de douleurs ou de gêne excessives lors du cycle menstruel, il ne faut jamais hésiter à consulter un médecin ou une gynécologue pour évoquer ces ressentis.
Quelle quantité de sang perd-on ?
En réalité, le volume que représentent les saignements lors des menstruations n’est pas aussi important qu’on se l’imagine. En effet, la perte de sang s’évalue en moyenne entre 5 ml à 25 ml. Si votre flux est trop abondant, reportez-vous au score de Higham. Ce tableau vous permet de le calculer à l’aide d’un tableau où vous comptabiliserez le nombre de protections hygiéniques quotidiennes utilisées sur le cycle. Pour chaque serviettes et tampons utilisés est attribué un certain nombre de points. À la fin des règles, on additionne les points. Si le score de Higham dépasse les 100 points, on estime que les saignements sont supérieurs à 80 ml. On parle alors d’hémorragies menstruelles ou règles hémorragiques pouvant justifier une consultation chez la gynécologue.
Règles irrégulières ou en retard : c’est grave ?
Lors du premier cycle menstruel et des suivants, il n’est pas rare d'avoir ses règles en avance . Ce phénomène peut durer deux ans, le temps pour le système hormonal d’arriver à maturation.
En cas d’absence de menstruation (aménorrhée), le premier réflexe est d’écarter d’abord l’éventualité d’une grossesse. Si l’absence perdure sans grossesse, d’autres pistes peuvent être explorées :
- Anomalie de la muqueuse utérine ou de l’ovaire ;
- Syndrome des ovaires polykystiques (SOPK) ;
- Ménopause ;
- Pilule contraceptive mal dosée ;
- Pratique sportive intense ;
- Choc psychologique ;
- Traitements médicamenteux ;
- Anorexie.
Quels sont les signes de l’endométriose ?
L’endométriose est une maladie qui se caractérise par la présence de tissu semblable à l’endomètre (muqueuse utérine) hors de la cavité utérine. Cette affection peut coloniser les organes suivants :
- Ovaire ;
- Vagin ;
- Vessie ;
- Ligaments utérosacrés ;
- Rectum.
Les lésions réagissent aux hormones féminines comme le ferait la muqueuse utérine. Elles saignent au moment des règles et laissent des cicatrices à chaque cycle menstruel. L’endométriose concerne de nombreuses femmes. Cette affection toucherait 1 femme sur 10, en âge de procréer.
Les symptômes de l’endométriose sont les suivants :
- Douleur dans la région pelvienne récidivante et intense ;
- Dysménorrhée (menstruations douloureuses) ;
- Dyspareunie (rapports sexuels douloureux) ;
- Troubles de l’infertilité.
À quel âge survient la ménopause ?
Lorsque les règles s’arrêtent définitivement, on parle de ménopause. Elle se manifeste en moyenne entre 45 et 55 ans. Ce phénomène naturel s’explique par une carence irréversible de certaines hormones (œstrogènes et progestérone). La ménopause marque la fin de l'ovulation. Elle est précédée par une période de périménopause allant de deux à quatre ans. Cette étape charnière se caractérise par :
- Des menstruations irrégulières ;
- Un syndrome menstruel ;
- Des bouffées de chaleur ;
- Des sueurs nocturnes.
La ménopause est officiellement déclarée après une année sans règles. Ses symptômes peuvent regrouper :
- Frissons, tremblements ;
- Sensations de chaleur intense ;
- Palpitations ;
- Sueurs abondantes ;
- Sécheresse vaginale ;
- Troubles urinaires ;
- Maux de tête ;
- Fatigue ;
- Troubles du sommeil ;
- Troubles de l’humeur ;
- Douleurs articulaires.
On parle de ménopause précoce lorsque la disparition des règles intervient chez une femme avant l'âge de 40 ans. Cette insuffisance ovarienne primitive (IOP) toucherait une femme sur cent.
Syndrome du choc toxique : que faut-il savoir ?
Le syndrome du choc toxique (SCT) est une infection grave, provoquée par le staphylocoque doré. Cette bactérie présente naturellement dans notre flore vaginale peut être à l’origine de graves complications lorsque l’environnement est propice à sa prolifération. Ce qui est notamment le cas quand le sang stagne dans le vagin. Sont visées en particulier, les protections hygiéniques internes comme le tampon ou la cup, portés trop longtemps. D’après les médecins, le risque de SCT serait multiplié par deux en gardant un tampon ou une cup plus de six heures. Le risque de SCT serait multiplié par trois en gardant un tampon ou une cup toute la nuit.
Les précautions à prendre pour se prémunir du syndrome du choc toxique sont alors simples :
- Changer de protection interne toutes les 4 heures ;
- Ne pas utiliser de protection interne pendant la nuit.
La meilleure solution consiste donc à alterner protections hygiéniques internes et protections hygiéniques externes type culottes menstruelles. Réalisées dans une matière OEKO-TEX® STANDARD 100 (certifiant l’absence de substance chimique nocive pour la planète ou votre santé), elles sont garanties anti-fuite, anti-humidité et anti-odeur. Cerise sur le gâteau, elles peuvent absorber entre 15 et 20 ml de sang, ce qui vous permet de vivre vos règles en toute liberté et en toute sécurité.
Par Valérie.